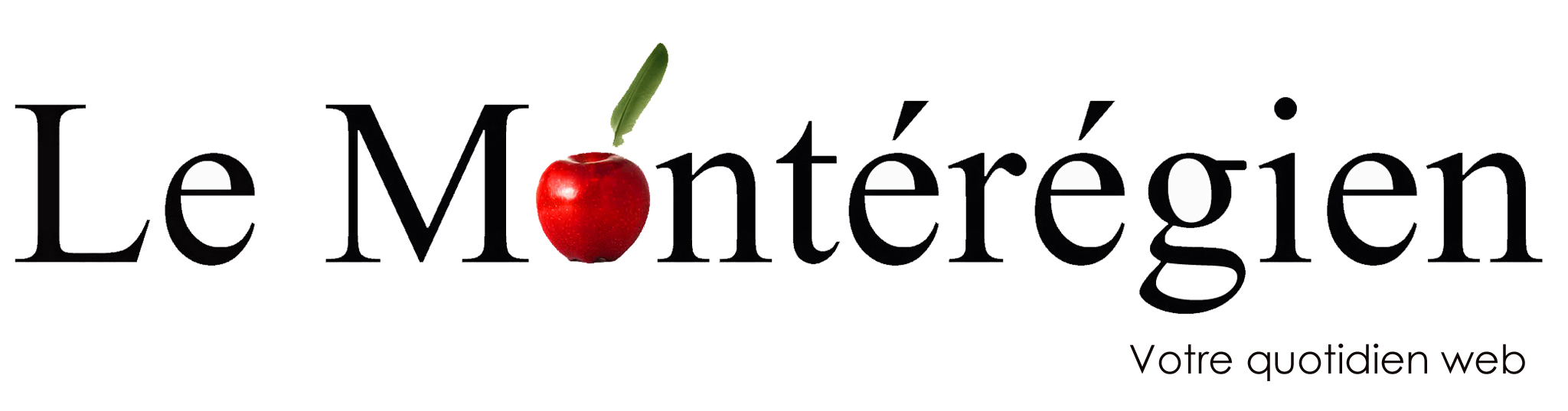OPINION – Le 1er octobre, le Parti Québécois a vécu l’une des défaites électorales les plus cinglantes de sa longue histoire. L’oraison funèbre maintes fois repoussée put enfin être prononcée par des chroniqueurs trop satisfaits de voir leur don de clairvoyance enfin démontré. « Le Parti ne se remettra jamais de cette débandade! Ce champ de ruines, dirent-ils en paraphrasant Jacques Parizeau, n’est plus simplement une vue d’esprit! »
Faisons un bref retour en arrière afin de bien comprendre les causes profondes de cette déconvenue. Le Parti Québécois a été cantonné dans l’opposition pour l’essentiel de ces 15 dernières années. Alors, pourquoi le jugement et la perception de plusieurs à son égard demeurent-ils aussi tranchés? Pourquoi les politiques majeures adoptées par ce parti depuis 40 ans ne font-elles pas contrepoids aux décisions plus controversées qui ont jalonné son histoire?
D’abord, il serait odieux de faire porter le blâme à Jean-François Lisée, car comme le disait John F. Kennedy, « la victoire a cent pères, mais la défaite est orpheline ». Ce déclin prend plutôt racine dans la défaite crève-cœur de 1995. Lucien Bouchard disait qu’un ressort s’était vraisemblablement brisé chez les Québécois, à ce point précis de leur histoire.

La grisaille des années 2000, avec l’élection des libéraux au Québec, a ensuite alimenté une forme de désabusement tranquille. Les problématiques de corruption, la perte de confiance dans les institutions, l’utilisation de la péréquation par le fédéral comme arme de dissuasion massive, le dénigrement de l’action politique, le cynisme généralisé, le détournement d’une génération, plus intéressée à être citoyen du monde et à prôner une ouverture frôlant parfois le renoncement de soi, devinrent un fardeau supplémentaire à porter. D’échec en échec, de recul en recul, le chemin des victoires devint ainsi un chemin de croix.
La peur d’un troisième échec a donc imprégné les pensées et figé les actions. Nous avons assisté, impuissants, à la fragmentation continue de l’alliance hétéroclite d’indépendantistes de gauche comme de droite. Le jeu d’équilibristes impossible des chefs péquistes depuis 1995 témoigne de cette difficulté. Écartelés entre deux courants idéologiques opposés, ils ne peuvent que décevoir les « solidaires » et les « lucides » simultanément.
Dans son rapport « Osez repenser le Québec », Paul Saint-Pierre Plamondon avait relevé l’impact concret de ce problème. Il faisait, entre autres, état d’un manque de constance dans les enlignements politiques du Parti : Du nationalisme civique de M. Boisclair en passant par l’épisode de la charte de M. Drainville, de l’indépendantisme décomplexé de M. Péladeau à un report dans un deuxième mandat de M. Lisée, du déficit zéro de M. Bouchard aux vaines tentatives de séduction de Québec solidaire, ces tiraillements constants devinrent de plus en plus perceptibles.
Toutes ces circonvolutions politiques, au gré de cette valse des chefs, ont contribué à altérer l’image même du Parti Québécois. Comment est-il possible de maintenir une ligne directrice claire et nette alors que six chefs, de leurs bras meurtris, se sont tendu le flambeau en vingt ans? Pendant cette même période, le Parti libéral fut dirigé par deux chefs et la CAQ/ADQ, trois (en excluant le bref règne de Gilles Taillon).
Ce jeu de chaise musicale et ces louvoiements démontrent la difficulté à rebâtir une feuille de route crédible. Maintenant, comment mettre fin à ce cycle stérile? Il faut d’abord s’affranchir de ce défaitisme. En clair, il faut revenir, pour de bon, à un discours indépendantiste affirmé. Nous devons cesser d’ergoter sans cesse sur la mécanique référendaire, dixit les conditions gagnantes, un énième livre blanc et l’éternelle question du « quand ». Cette boîte de Pandore dans laquelle nous ont enfermés les fédéralistes doit être refermée à double tour. À ce sujet, le livre de Simon-Pierre Savard-Tremblay, « Le Souverainisme de province », devrait servir de livre de chevet à tous les indépendantistes.
Il faut s’opposer avec véhémence à cette trame narrative écrite par d’autres où le PQ serait condamné à mourir encore et encore, dans une sorte d’anomie collective. Pour certaines personnes, le problème de ce parti serait son article 1. Les « raisins de la colère » et le sentiment d’aliénation ne sont effectivement plus un moteur d’action politique chez bon nombre de Québécois. Le confort amène son lot d’indifférences. Mais le futur n’est pas une marche linéaire. Un renoncement définitif de cet idéal serait pire encore; il suffit de regarder les résultats du 1er octobre pour s’en convaincre. Un PQ délesté de sa raison d’être historique serait nécessairement condamné au bas de page de l’histoire, à brève échéance. L’espace politique est, de toute manière, saturé à gauche comme à droite.
Finalement, serait-il aussi possible que l’appellation même « Parti Québécois », qui cristallise les rêves de changement et d’émancipation depuis 50 ans, nous renvoie aujourd’hui essentiellement à nos échecs? Personne n’aime être confronté à ses insuccès. Le Parti Québécois serait-il devenu injustement le paratonnerre de nos insatisfactions collectives? Les attentes nécessairement trop élevées à son égard ont peut-être engendré un effet de ressac, un désabusement excessif chez l’amoureux québécois transi. Ce simple nom, « Parti Québécois », pourtant si beau, est peut-être irrémédiablement connoté. Un changement de nom s’impose peut-être, comme le mentionnait judicieusement Jean-Martin Aussant.
Il y a sans doute, dans ces prises de conscience douloureuses, mais néanmoins nécessaires, les germes d’une possible renaissance. Comme Bernard Landry le disait avec tant d’éloquence : l’indépendance n’est ni à gauche ni à droite, elle est en avant. En cette saison des refondations, une nouvelle voie pourrait émerger de ce brouillard national et réactiver les espérances. Le PQ doit se transformer, non pas pour devenir le nouveau « Like » du mois, mais pour s’affranchir d’un poids historique devenu, peut-être, trop lourd à porter.
Charles Fraser-Guay
Chambly